L'histoire de la Polynésie française en 101 dates
Disponible sur amazon à cette adresse
www.amazon.fr/dp/2955686018 et dans toutes les librairies, le
livre d'Alexandre Juster : "L'histoire de la
Polynésie française en 101 dates".
En 138 pages, vous découvrirez quelles sont les dates incontournables de
la Polynésie française, quand ont eu lieu les tragédies, les batailles,
les conquêtes et les annexions des Maòhi dans le Pacifique, mais aussi
les grands travaux, les protectorats, les victoires électorales et les
statuts d'autonomie qui ont construit le fenua.
Dates après dates, voici l'histoire de la Polynésie française.
- Toute l'histoire, même celle qui repose dans la littérature orale,
décrivant la période pré-européenne.
- Toute la Polynésie française, c'est à dire Tahiti, Bora Bora mais
également les Marquises, les îles Australes, les Gambier et les Tuamotu
pratiquement inhabités.
- Tous les événements, des plus graves comme les engagements des Poilus
tahitiens de la Première Guerre Mondiale aux plus légers, comme la
quatrième place remportée face au Brésil par Tahiti à la coupe du monde
de beach soccer.
C'est enfin l'histoire de la Polynésie française, telle que l'ont
ressenti ses habitants. Dans ce livre, ce n'est pas Wallis ou
Bougainville qui découvrent Tahiti, mais les Tahitiens qui découvrent
ces navigateurs européens, bizarrement vêtus.
Prix de vente conseillé : 9,50€ pour la version livre de poche ou 4,50€
pour la version électronique.
 "Il faut océaniser l’histoire et son
enseignement"
"Il faut océaniser l’histoire et son
enseignement"
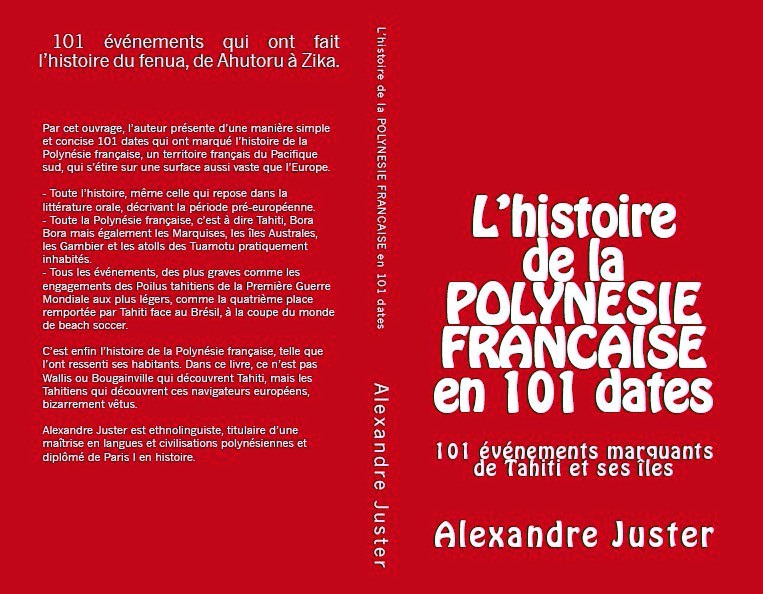
PAPEETE, le 22 septembre 2016 - Alexandre Juster,
ethnolinguiste, titulaire d’un master en langues et cultures
océaniennes, vient de signer un ouvrage intitulé L’histoire de la
Polynésie en 101 dates. Il raconte Tahiti et ses îles à travers les
évènements marquant du territoire. Rencontre.
Alexandre Juster a obtenu en 2007 son master en langues et cultures
océaniennes en travaillant sur les sociétés et les langues kanakes et
polynésiennes. Après dix années d’échanges, de travail d’enquête il
s’est finalement installé à Paris où il a donné des cours de
civilisation polynésienne à la Délégation de Polynésie française. Il est
l’auteur de L’histoire de la Polynésie en 101 dates qui vient de
paraître.
Pourquoi un tel projet?
"Ce sont mes étudiants de la Délégation
de la Polynésie à Paris qui m’ont demandé d’écrire ce livre. Ils ne
parvenaient pas à trouver un livre qui compile les dates marquantes de
l’histoire du fenua. Il y a Internet, bien sûr, mais tout n’est pas
forcément exact, ou neutre, sans parti pris. Je voulais écrire quelque
chose de simple et qui replace la Polynésie et ses habitants au centre
du jeu historique. L’histoire mondiale s’est jouée bien des fois ici :
en 1843 et dans les années 1880, Tahiti a été le centre de tensions
diplomatiques très fortes entre la France et le Royaume-Uni. De même, la
Nouvelle-Zélande aurait bien aimé annexer Rapa, et que dire du
bombardement allemand sur Papeete en 1914, de l’accueil de la base
militaire américaine à Bora bora en 1942 et de la construction du CEP ?"
Pourquoi avoir retenu précisément 101 dates?
"Il aurait été plus commun de proposer
100 dates, ce qui aurait fait un chiffre rond. En ajoutant une date de
plus à ce chiffre rond, je voulais indiquer que l’histoire ne s’arrête
pas, qu’elle déborde en permanence du cadre. De plus, dans la numération
traditionnelle polynésienne, on employait le terme "tūmā" pour nommer un
excédent par rapport à un nombre rond. La cent-unième date est ce "tūmā",
car en lisant mon livre, le lecteur voit finalement défiler sous ses
yeux bien plus que 101 dates."
Comment les avoir sélectionnées?
"Par souci de rééquilibrage, je tenais
absolument à mentionner des dates de l’histoire de tous les archipels.
On ne parle pas assez des guerriers d’Anaa, du bagne de Nuku hiva, de la
guerre des îles Sous-le-Vent dont les participants ont été exilés en
Nouvelle-Calédonie ou aux Marquises. Et on parle encore moins de la
tentative d’annexion allemande du royaume de Bora Bora en 1879 ! On
trouve encore dans des livres histoires ceci : "à l’origine, ces îles
ont été peuplées par des navigateurs polynésiens" puis, immédiatement
après : "en 1767 Wallis a découvert Tahiti". Cela est faux, ce n’est pas
Wallis qui a découvert Tahiti, mais les premiers navigateurs polynésiens
qui ont peuplé cette île. En 1767, ce sont les Polynésiens qui ont
découvert Wallis et non l’inverse. Il faut océaniser l’histoire et son
enseignement. Enfin, je voulais rééquilibrer dans le temps les
événements historiques et combler ce vide qu’il existe entre le premier
peuplement et 1767. Je me suis penché pour cela sur la littérature orale
et les confidences que Tupaia a faites aux missionnaires."
Quelles sont celles qui vous ont le plus "marqué"?
"L’ouverture de la première session de
l’Assemblée des Chefs, en février 1824. À cette occasion, les tāvana
décident, après de longues discussions, d’abolir la peine de mort,
instituée cinq ans auparavant dans le code de loi rédigé par Pomare II
et les missionnaires. C’était la première fois au monde qu’une assemblée
législative d’un état indépendant abolissait la peine capitale. Le
cyclone du 15 janvier 1903 est également un événement marquant. En
frappant les Tuamotu, il tue 519 personnes, soit 10% des habitants de
l’archipel."
Sur quoi vous êtes-vous appuyé pour les détailler?
"Outre les travaux des chercheurs comme
Bruno Saura, Jean-Marc Regnault ou Pierre-Yves Toullelan, j’ai puisé
dans la littérature orale et dans les témoignages des premiers étrangers
débarquant d’Europe. Mais ces deux sources ont leurs limites, il faut
prendre tout cela avec des pincettes. Pour la littérature orale, il faut
distinguer les apports extérieurs et modernes que les informateurs
polynésiens ajoutaient aux récits anciens. Quant aux témoignages des
premiers européens, il n’y a qu’à voir combien le pasteur William Ellis
met l’accent sur les aspects "sauvages" de la société ancienne, comme
les sacrifices rituels, les infanticides et les guerres pour comprendre
qu’il tient à légitimer son travail d’évangélisation et sa réussite.
Habitant dans le sud de la France, j’ai la chance de ne pas être trop
loin des archives d’outre-mer d’Aix en Provence. J’y ai consulté les
premiers journaux officiels, les traités de protectorat ou d’annexion
des différentes îles ainsi que rapports et les fiches de police du
commissaire Tabanou, en fonction à Papeete de 1877 à 1904. En 27 ans,
cet homme a connu la mort de la reine Pomare, la fin de la monarchie et
les premières années de la colonisation."
À qui s'adresse cet ouvrage?
"Aux adultes, aux enfants. À ceux qui
veulent connaître l’histoire de la Polynésie française et à ceux qui
souhaitent se rafraîchir la mémoire. Les lecteurs trouveront aussi bien
des événements sérieux, graves, comme la destruction du marae
Taputapuatea par les guerriers de Bora Bora, et des faits plus légers,
comme l’arrivée de la télévision ou la construction de l’aérodrome de
Raiatea."
Quels sont les thèmes de vos prochains ouvrages?
"Le prochain qui doit sortir avant Noël
a pour thème la mythologie polynésienne, de la Nouvelle-Zélande à
Hawaii, en passant par la Polynésie française bien sûr ! "
ça s'est bien passé
A partir, du 6 octobre 2015, des cours de
civilisation polynésienne seront proposés à la Délégation de la
Polynésie française à Paris.
Tous les mardis, de 18h00 à 19h30, Alexandre
Juster, diplômé d’histoire à Paris 1 et titulaire d’une maîtrise
en langues et civilisations océaniennes, s’attachera à faire
découvrir l’histoire, la géographie et l’ethnologie du territoire.
Repartis sur 30 modules de 1h30 chacun, les cours
présenteront les 2000 ans d’histoire de cette partie de l’Océanie et
des hommes qui la peuplent.
Vous trouverez ci-dessous, le programme détaillé.
Pour tous renseignements sur les tarifs et les
modalités de paiement, merci de contacter :
Alexandre Juster - Courriel :
civilisation987@yahoo.fr
Inscrivez-vous vite, les places sont limitées !
6 et 13 octobre 2015.
I. Présentation de l'Océanie et de la Polynésie
française.
L'Océanie, "le continent oublié" selon Le Clézio, se
définit par l'immensité. Espace de tous les records, elle concentre
également tous les statuts possibles d'autonomies que peuvent avoir
des territoires non souverains. Après avoir traité des aspects
géopolitiques, nous examinerons la géographie unique des ces pays,
dépendant en tous points de l'Océan Pacifique qui les entoure. De ce
fait, le Pacifique Sud est un véritable laboratoire pour la
communauté scientifique, où de nombreux programmes sont créés. Puis,
le champ d'étude se réduira sur la Polynésie française avec une
première approche sur sa population, ses îles et son autonomie.
20 et 27 octobre2015.
II. Le peuplement.
Le peuplement de l'Océanie a suscité, et en suscite
encore de nombreuses interrogations : D'où viennent les
Polynésiens, qui sont les Austronésiens ? Avec quels moyens et
quelles techniques sont-ils parvenus à coloniser toutes les îles du
Pacifique ? Quelles sont les preuves scientifiques de leurs origines
et quelle trace reste t'il dans la littérature orale de leur
conquête. Où s'établirent les premiers découvreurs, quelle culture
commune partageaient-ils ?
03 et 10 novembre 2015.
III. Les premiers contacts.
Les habitants de Tahiti découvrent les "hommes à la
peau blême" (V. Ségalen) près de 200 ans après les Marquisiens. Nous
décrirons la nature des ces contacts entre marins et Mélanésiens et
Polynésiens et les raisons des expéditions européennes. Nous nous
pencherons sur le système politique qui prévaut en Polynésie et sur
les récits des navigateurs européens qui ont vite inventé la
dichotomie entre la Polynésie heureuse et la Mélanésie peuplée de
sauvages sanguinaires. Nous verrons enfin que ce sont les derniers
instants où les Océaniens sont maîtres de leurs destins avant la
décolonisation.
17 et 24 novembre 2015.
IV. Les "king makers" et l'évangélisation en
Polynésie.
Les visiteurs européens ont besoin d'avoir un
interlocuteur unique lors de leur escale et recherchent pour des
raisons pratiques une similitude politique avec leur pays d'origine.
Ils font alors des chefs des clans qu'ils rencontrent les rois des
îles visitées. L'aspect social et politique commence à être
bouleversé, et ces chefs, souvent en situation de faiblesse, savent
se servir des Européens pour étendre leur pouvoir.
L'Océanie et ses terres nouvelles pour les
évangélisateurs forment un regain d'intérêt pour les différentes
missions religieuses, créés spécifiquement à cette occasion. Quels
impacts ont ces missions au sein des populations, et quels
mouvements de résistance se mettent en place ?
1er et 08 décembre 2015.
V. Le Protectorat sur Tahiti
La France, qui avait manifesté peu d'intérêt pour la
Polynésie, se trouve en 1842 à exercer un protectorat sur l'île de
Tahiti et à annexer les Iles Marquises. Nous dresserons le portrait
de la reine Pomare IV et des premiers Européens venus s’installer
dans ces îles.
Nous verrons enfin que la mise en place du
Protectorat ne s’est pas fait sans heurts entre la France et le
Royaume-Uni et la résistance de certains habitants à ce système
politique aboutira à la guerre franco-tahitienne.
15 décembre 2015.
VI. Présentation de Papeete.
Une description de la ville contemporaine permet de
mieux situer l’histoire de la Polynésie française. Nous étudierons
les raisons qui ont poussé à créer cette ville sur un territoire
autrefois marécageux. Nous verrons les événements historiques qui
ont marqué cette ville et lui ont donné son visage actuel.
12 janvier 2016.
VII. Colonisation et décolonisation en Océanie.
A partir du XIXè siècle, les puissances européennes,
américaines et asiatiques partent à la conquête des îles du
Pacifique. Nous nous pencherons sur les raisons communes et sur les
différences qui ont poussé ces pays à coloniser ce vaste territoire,
où seront initiés moins d’un siècle plus tard les premières
décolonisations.
19 et 26 janvier 2016.
VI. Les prises de possession françaises en Polynésie
orientale.
Comment la France fait-elle évoluer son protectorat
sur l'île de Tahiti en une annexion et pourquoi étend-elle dans la
seconde moitié du 19è siècle sa colonisation à d'autres îles du
Pacifique : les Australes, Tuamotu, Iles Sous le Vent,
Nouvelle-Calédonie, Iles Loyauté, Wallis et Futuna.
02 et 09 février 2016.
VII. La IIIème République dans les Etablissements
Français de l'Océanie.
La nouvelle colonie des Etablissements Français de
l'Océanie fait appel à une main d'œuvre étrangère pour développer
son économie, des travailleurs chinois. Mais cette colonie est
confrontée à des problèmes sanitaires immenses, qui ont pour
conséquence la diminution drastique du nombre de ses habitants.
Cette colonie, aux antipodes de la métropole tombe peu à peu dans
l'oublie et vit au rythme des steamers et autres goélettes. Mais par
deux fois en moins de 50 ans, les Polynésiens briseront cet oubli et
serviront cette métropole, "Mère Patrie", en allant combattre au
cours des Guerres Mondiales.
16 février 2016.
VIII. L’art océanien.
Ce que les collectionneurs et les musées actuels ont
élevé ont rang d’œuvres d’art sont avant tout, pour la plupart, des
objets usuels. En nous penchant sur le cas du tatouage et des
scarifications, nous nous attarderons sur la vie sociale des hommes.
En étudiant le cas des tiki marquisiens, nous développerons
le rôle des divinités et du système religieux à l’époque
pré-européenne. Nous retracerons enfin le parcours de certains de
ces objets jusqu’aux musées européens et analyserons l’impact qu’ils
ont eu dans les mouvements artistiques du XXè siècle.
08 et 13 mars 2016.
VIII. Le nationalisme tahitien : 1947 à 1960.
L'après guerre dans les EFO voit le retour des
combattants du "Bataillon des Guitaristes". La France souhaite
accorder un nouveau statut à ses colonies, celui de Territoire
d'Outre Mer. Comme dans d'autres TOM, des partis politiques locaux
vont voir le jour car malgré ce changement de statut le ressentiment
et les déceptions d'après guerre sont nombreux dans la communauté
tahitienne.
C'est avec la loi cadre de Gaston Deferre que les
avancées démocratiques vont s'accélérer; création d'un gouvernement
avec à sa tête un certain Pouvanaa a Oopa qui souhaite que les
populations tahitiennes soient reconnues et traitées à leur juste
valeur, et que le mépris de la petite communauté métropolitaine vis
à vis des Tahitiens s'arrête.
22 et 29 mars 2016.
IX. Le Centre d'Expérimentation du Pacifique.
Au début des années 60, à la fin de la guerre
d'Algérie, la France perd ses sites d'expérimentation nucléaire dans
le Sahara algérien. Les atolls polynésiens de Moruroa et de
Fangataufa sont choisis pour effectuer les essais aériens
nucléaires. La Polynésie française devient la tête de pont de la
dissuasion nucléaire française et les militaires, les vivres, les
loisirs débarquent en masse à Tahiti. Tout est construire : pistes
d'aviation, casernes, logements, cinéma, écoles, lycée, etc. Le
travail se monétarise et l'économie s'affole, les subventions
pleuvent et le territoire croule sous les richesses ; mais à quel
prix ? Le CEP est certes une manne pour le territoire mais il
inquiète et ternit l'image de la France dans le Pacifique.
05 avril 2016.
X. Les premières autonomies : 1977-1996.
Face au mouvement mondial de décolonisation, la
France est contrainte de lâcher du lest en Polynésie française. En
1977 le territoire est doté d'une autonomie de gestion, une
autonomie approfondie en 1984. Alors que la Nouvelle-Calédonie, au
bord de la guerre civile, connaît une avancée statutaire majeure, la
Polynésie française se voit doté, après la fin des essais
nucléaires, d'une autonomie élargie en 1996.
12 avril 2016.
X. L’autonomie actuelle.
En 2004, un nouveau statut d’autonomie est accordé à
la Polynésie française. Les nouvelles compétences acquises par cette
collectivité sont-elles les dernières possibles avant une entière
souveraineté ? Nous étudierons en détails les compétences qu’excercent
l’Etat, la Polynésie française et les communes. Ce statut est le
point de départ d’une longue et profonde crise institutionnelle et
politique dont nous verrons les tenants et les aboutissants.
03, 10 et 17 mai 2016.
XI. Présentation des pays environnants.
Nous étudierons l’histoire, la politique et la
géographie de 9 pays et territoires océaniens (Tonga, Samoa,
Nouvelle-Zélande, Fidji, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, Iles de
Pâques, Pitcairn, Hawaii). Nous analyserons l’intégration régionale
de la Polynésie française et les liens entretenus avec ces
différents territoires.
24 mai et 1er juin 2016.
XII. Géographie de la Polynésie française.
Que recèle et comment s’organise un territoire de 5
millions de km² ? Nous étudierons la situation géographique de la
Polynésie française. Nous nous pencherons sur les différents types
d’îles (atolls, îles hautes et atolls surélevés) ainsi que sur les
défis écologiques et économiques auxquels ces îles sont confrontées.
Enfin, nous nous attarderons sur la géographie maòhi et
comment les hommes qui peuplent ces îles organisent leur espace
selon leur environnement naturel.
07 et 14 juin 2016.
XIII. Portraits d’hommes politiques océaniens.
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française,
territoires français océaniens, ont vu naître des figures politiques
majeures qui ont influencé l’histoire de ces îles dont les
générations actuelles continuent de s’en inspirer. Nous étudierons
d’abord la vie et la carrière politique d’Oscar Temaru, de Pouvanaa
a Oopa et de Jean-Marie Tjibaou, d’une part, trois hommes qui
voulaient d’autres rapports entre la Métropole et leur pays. Nous
nous pencherons ensuite sur les vies de Gaston Flosse, Francis
Sanford et Jacques Lafleur, trois personnalités politiques classés
dans le courant autonomistes.